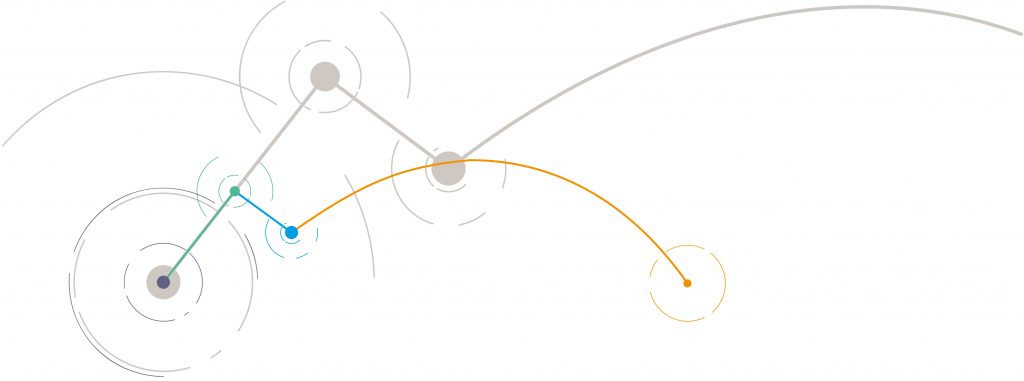Quand les enfants vont mal : comment les aider ?
Pris dans un effet ciseaux entre l’augmentation de la demande et le déficit structurel de l’offre de soin, les enfants sont plus exposés que les adultes à la souffrance psychique, mais aussi à la médication. Les niveaux d’augmentation (2 à 20 fois plus élevés, selon les molécules) sont sans commune mesure avec ceux observés au niveau de la population générale. Enfin, les moyens dédiés aux soins de première intention, et le déploiement des dispositifs psychothérapeutiques, éducatifs et sociaux ne semblent pas avoir augmenté dans les mêmes proportions.
On constate ainsi une difficulté d’accès non seulement à des soins pédopsychiatriques mais aussi à des mesures de prévention, d’éducation et d’accompagnement, et les facteurs d’inégalités sociales accentuent encore les effets de cette situation.
Du côté des familles, le manque de repère, de lisibilité, puis d’accès aux professionnels fait obstacle à la mise en place d’un parcours de soin et d’accompagnement adapté, inscrit dans la durée.
La difficulté à trouver les bons interlocuteurs qui pourront aider l’enfant et sa famille vient alors s’ajouter à l’épreuve familiale qui se joue quand un enfant qui va mal, et aux autres fragilités qui frappent plus fortement les familles ces toutes dernières années au travers de crises multiples.
Les travaux du HCFEA ont permis de documenter les biais scientifiques et médiatiques susceptibles d’impacter les politiques publiques en de santé mentale de l’enfant ainsi que des impasses de la recherche et des pratiques biomédicales en ce domaine. L’état des lieux des recherches les plus récentes, ainsi que les dernières recommandations des agences internationales (OMS) plaident pour une réorientation des recherches et des politiques publiques dédiées aux enfants en difficulté psychologique vers des pratiques psychothérapeutiques, éducatives et les interventions sociales.
Rapport du Conseil de l’enfance et de l’adolescence « Quand les enfants vont mal : comment les aider ? » – adopté le 7 mars 2023