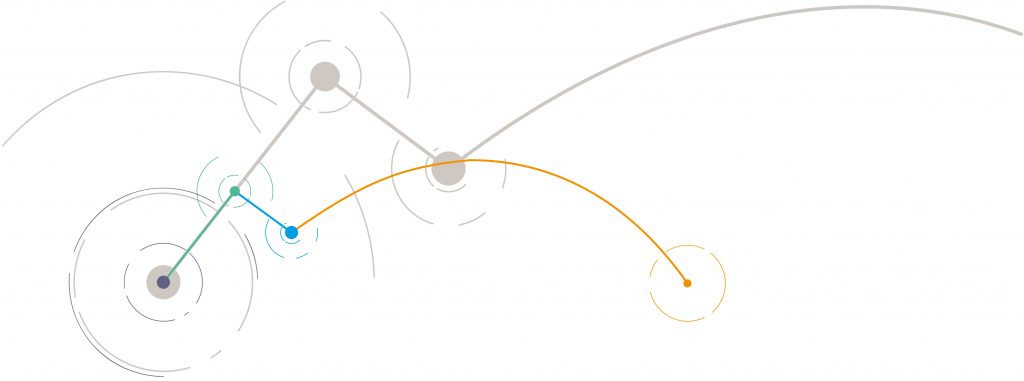Qualité, flexibilité, égalité : un service public de la petite enfance favorable au développement de tous les enfants avant 3 ans
Les modes d’accueil de la petite enfance sont des structure d’intérêt général qui ont une fonction sociale, éducative, de prévention primaire et de soutien à la parentalité. Leur qualité est à refonder du point de vue des enfants, de leur développement affectif, physique, intellectuel et social, et dans un projet de meilleure égalité pour tous dès le début de la vie.
57 % des tout-petits garçons et des toutes-petites filles vivant en France sont accueillis dans un mode d’accueil officiel, en l’absence de leurs parents, grâce à la confiance que leurs familles accordent à nos accueils collectifs et individuels. Mais que proposons-nous aux 43 % d’une classe d’âge qui n’accèdent pas à des offres d’accueils formels, alors que les bénéfices à moyen et long terme d’une socialisation progressive avant l’entrée à l’école sont démontrés ?
Il n’y a pas de séparation possible entre l’objectif qualitatif et quantitatif de l’offre dans la valeur d’un mode d’accueil car sur l’enfant, tout agit : l’accès, au moment que ses parents choisissent, la familiarisation progressive, l’implication et la compétence des professionnels, les normes, les locaux, l’équilibre financier de sa famille, … Or il y a un coût humain et social à long terme, lorsque les enfants sont mal accueillis, mais aussi lorsqu’ils pourraient bénéficier d’un accueil extra-familial et n’y accèdent pas.
Le développement et l’épanouissement des très jeunes enfants doit prendre place aux côtés des autres finalités des modes d’accueils que sont l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle, l’accompagnement de la parentalité, l’égalité entre mères et pères dans l’éducation des enfants et dans la société, l’égalité entre tous les enfants dans les processus de prime éducation, et de prime socialisation.
C’est pourquoi la connaissance des particularités du développement de l’enfant avant 3 ans, et de ses besoins fondamentaux (partie I), doit guider les objectifs d’une politique publique de la petite enfance. Elle intègre la place qu’y prennent les découvertes accompagnées par le jeu, la musique, les livres ou la nature, mais aussi la rencontre d’autres enfants, d’autres espaces. Cette connaissance doit aussi éclairer la formation des professionnels et l’évolution des modes d’organisation et de travail avec les très jeunes enfants, encore vulnérables et dépendants.
La notion d’« accueil de qualité » était une nébuleuse. Elle est mieux définie en tant que qualité affective, éducative et sociale depuis l’adoption de la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant en 2021 (Partie II). Mais nous n’avons pas réussi à faire de l’accueil un droit, ni d’une politique publique de la petite enfance une obligation. Il nous faut avancer vers un service public de la petite enfance, donc un service au bénéfice tous les enfants.
Dans son rapport « Qualité, flexibilité, égalité », le conseil de l’enfance du HCFEA propose le déploiement, dans le cadre d’un service public de la petite enfance, d’un ensemble d’accueils flexibles, pour proposer une première expérience de socialisation à tous les enfants dont les parents le souhaitent, avant trois ans.
La prime socialisation est favorable au développement du jeune enfant (Partie III). Elle l’est d’autant plus, dans certains cas de vulnérabilité potentielle et multiforme de l’environnement des enfants. Ses bénéfices sont démontrés et inspirent des initiatives parcellaires, dans et hors des modes d’accueil formels, depuis de nombreuses années. Or malgré leur utilité, ces initiatives sont mal identifiées par les familles et fragilisées par un manque de cadre administratif adapté à leurs objectifs pour en garantir la pérennité. Le non-recours à un mode d’accueil formel peut en partie être dépassé grâce à des offres plus diversifiées et mieux ajustées à la diversité des situations familiales et de leurs territoires de vie.
C’est pourquoi le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA propose de développer un parc de structures « d’accueils flexibles » inscrites dans la durée, avec des acteurs de proximité qui tissent des liens de confiance avec les parents. Cette catégorie d’accueils flexibles rassemblerait les espaces où enfants et parents peuvent partager des moments de socialisation, de jeu, de développement avec d’autres, hors de la maison et possiblement, évoluer vers un accueil de l’enfant seul, confié si le besoin s’en fait sentir.
Sous un format d’accès administratif simplifié, seraient réunis dans l’offre d’accueils flexibles des lieux d’accompagnement à la parentalité (Laep, Reaap avec enfants), mais aussi des lieux d’accueil du public (musées, ludothèques, centres sociaux…), ainsi que des accueils nomades (mobiles, de plein air…), des accueils et actions passerelles vers une familiarisation à l’école, et, si les structures formelles le permettent, des accueils hybrides incluant des formats flexibles, sur des temps ou espaces dédiés (ateliers en MAM, EAJE, REP…). L’ensemble constituerait, si besoin, un premier pas vers un mode d’accueil ou vers l’école.
L’ambition d’offrir à tous les enfants une expérience de socialisation progressive, ludique et stimulante avec d’autres enfants, en lien avec les parents, dans d’autres espaces que la maison, pourrait servir de base à l’édification d’un véritable service public de la petite enfance. Être bien accueilli dans la société dès ses premiers pas, découvrir d’autres enfants et être bien entouré répond à la fois à une appétence relationnelle et découvreuse de l’enfant, à un appui offert aux parents, et est le signe que chaque enfant a droit à une place dans la communauté des humains où il se trouve en confiance pour grandir.
Rapport du Conseil de l’enfance et de l’adolescence « Qualité, flexibilité, égalité : un service public de la petite enfance favorable au développement de tous les enfants avant 3 ans » – adopté le 18 avril 2023